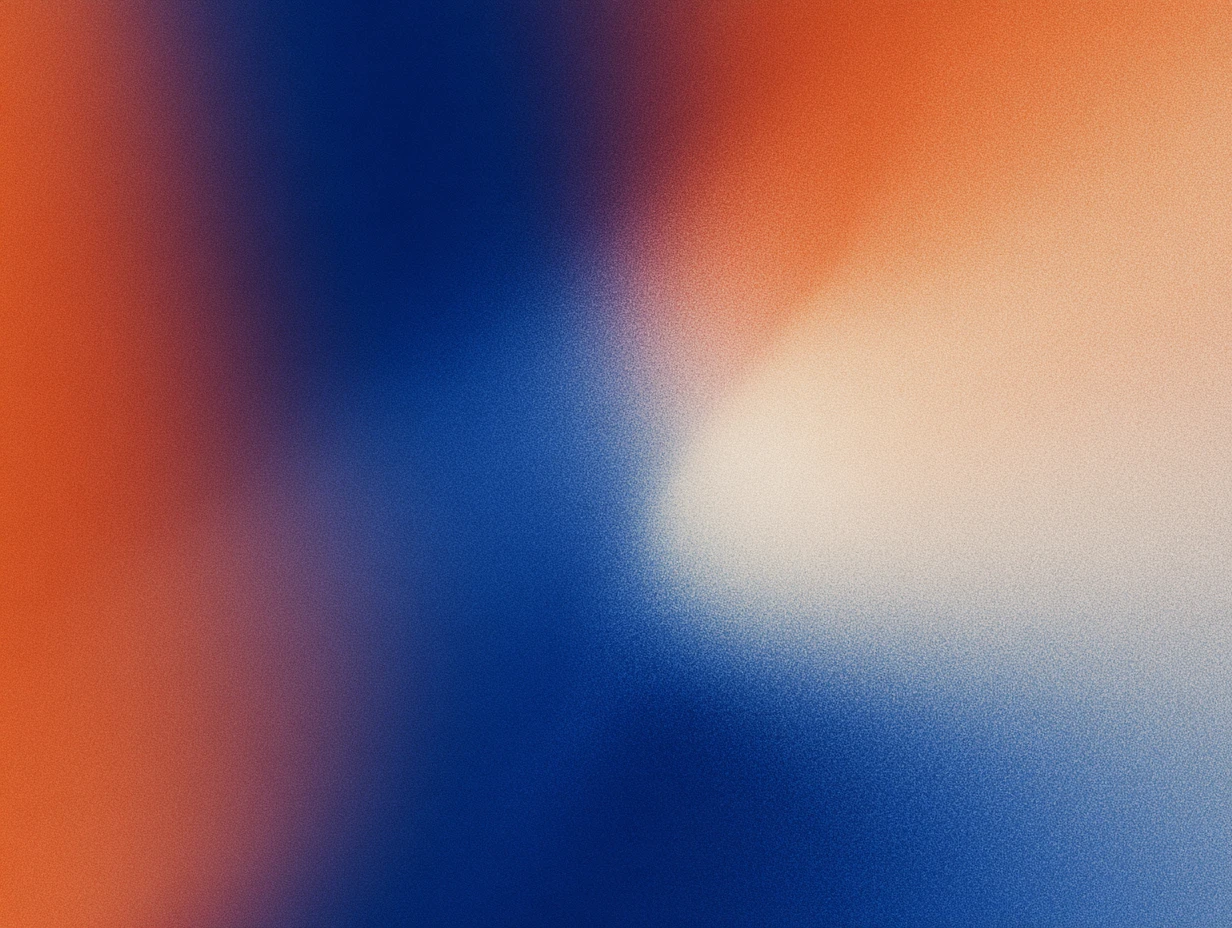Urbanisme & aménagement
Loi "Zéro artificialisation nette" : apport important du Conseil d'Etat
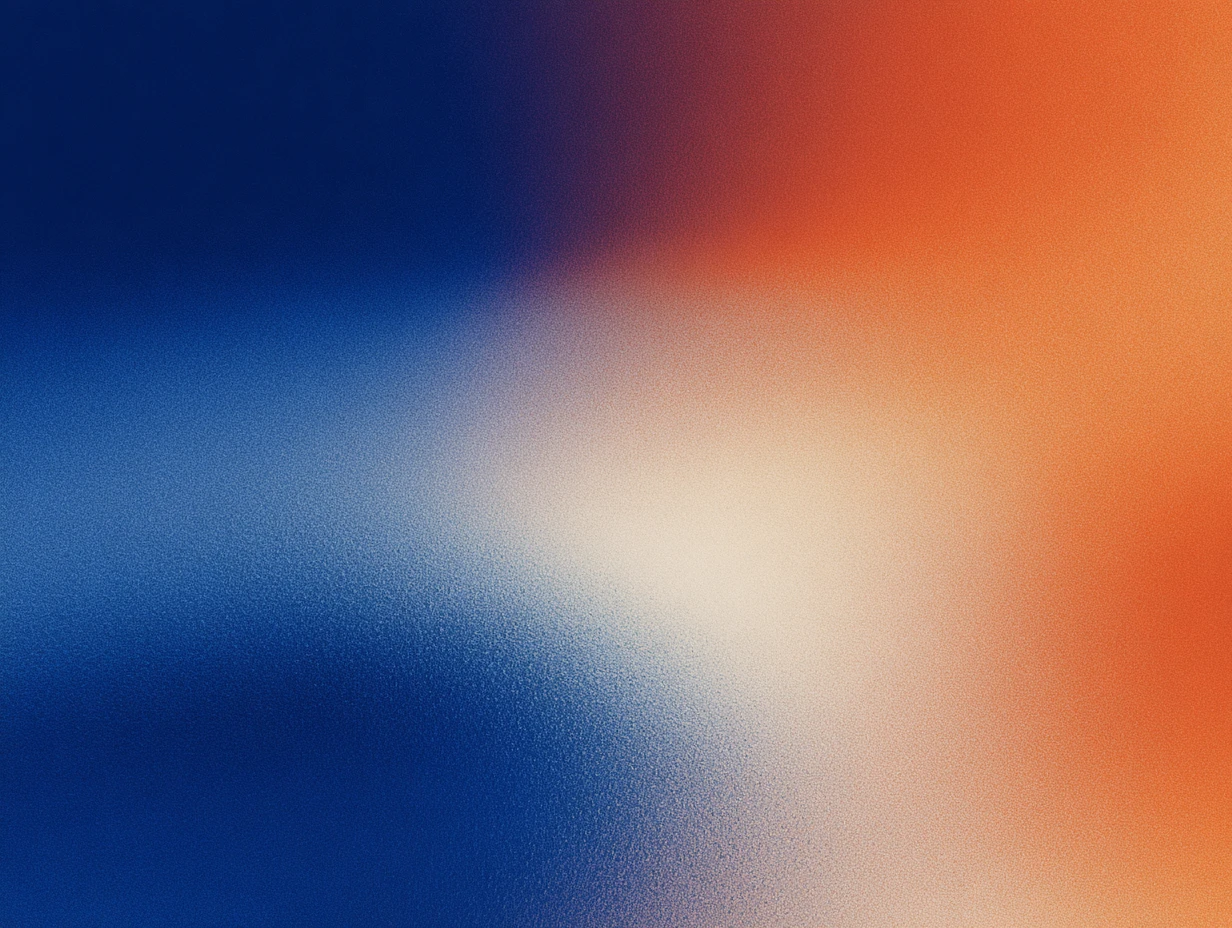
Dans le contexte de la réforme dite « zéro artificialisation nette » (ZAN), le Conseil d’État a été saisi par la commune de Cambrai d’un recours en annulation du fascicule n°1, publié par le ministère de la transition écologique fin 2023, destiné à préciser la définition et l’observation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) ainsi que l’artificialisation des sols.
La commune contestait (i) l’indépendance de cette consommation par rapport au zonage des documents d’urbanisme, et (ii) le critère du « démarrage effectif des travaux » comme point de départ de la consommation d’ENAF.
Cadre juridique :
- Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, art. 191 et 194 : objectifs nationaux de réduction de l’artificialisation nette et de la consommation d’ENAF.
- Article R.101-1 du Code de l’urbanisme (décret 2023) : qualification des sols selon l’occupation effective et non selon le zonage réglementaire.
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, institue à son article 191 un objectif national ambitieux : parvenir à « zéro artificialisation nette » des sols à l’horizon 2050. Elle entend ainsi juguler la disparition progressive des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) du territoire national.
Pour la période 2021-2031, l’article 194 de la même loi fixe un objectif intermédiaire contraignant : réduire de moitié la consommation d’ENAF par rapport à la décennie précédente. Il ne s’agit donc pas d’un simple affichage politique, mais d’un engagement obligatoire, traduisant une étape décisive sur la trajectoire de sobriété foncière.
Afin de rendre cet objectif opposable et opérationnel pour les acteurs locaux et porteurs de projets, la loi prévoit son intégration dans les principaux instruments de planification territoriale, selon une chronologie précise :
- Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) : intégration de l’objectif au plus tard le 22 novembre 2024 ;
- Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) : intégration au plus tard le 22 février 2027 ;
- Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et cartes communales, en l’absence de SCoT : intégration au plus tard le 22 février 2028.
La loi renforce l'effet normatif de ces dispositions par des mesures coercitives : à défaut d’adoption dans ces délais, l’urbanisation est strictement encadrée ou suspendue. Ainsi, faute d’entrée en vigueur du SCoT révisé, toute ouverture à l’urbanisation est gelée. À défaut de PLU ou de carte communale mis à jour, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée dans les zones à urbaniser ou les secteurs constructibles concernés.
En outre, pour prévenir tout contournement de ces objectifs en période transitoire, l’article 194 habilite expressément l’autorité d’urbanisme à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation qui compromettrait l’atteinte des objectifs de réduction, et ce jusqu’à l’adoption du document d’urbanisme intégrant ces nouveaux standards.
En synthèse :
Les porteurs de projet doivent donc intégrer, dès la conception de leurs opérations, la trajectoire réglementaire et opérationnelle fixée par la loi :
- Les droits à construire seront désormais déterminés à l’aune d’objectifs chiffrés et territorialisés de réduction de la consommation d’ENAF.
- Le respect du calendrier d’intégration dans les documents d’urbanisme conditionnera fortement la délivrance, voire la recevabilité même, des demandes d’autorisations d’urbanisme.
- Toute stratégie d’aménagement doit anticiper les risques de suspension ou de gel, voire de refus d’autorisations, pour défaut de conformité à ces obligations de sobriété foncière.
Décision et apports essentiels :
- Recevabilité du recours : Le Conseil d’État confirme la recevabilité du recours contre ce type de documents (guides, fascicules, instructions administratives), dès lors qu’ils produisent des effets notables sur les droits ou la situation des collectivités concernées (pt. 5-8), en l’espèce, car le fascicule traduit l’interprétation impérative de l’administration à l'égard de la définition juridique de la consommation d’ENAF.
- Portée juridique du fascicule :Le juge rappelle qu’un tel document peut être annulé s’il fixe une règle nouvelle ou méconnaît le sens et la portée du droit positif (pt. 10).
- Définition de la consommation d’ENAF : Le Conseil d’État retient que la consommation des ENAF ne résulte pas d’une simple inscription au zonage d’un PLU, mais de la transformation constatée sur le terrain, indépendamment de la qualification réglementaire. Autrement dit, une parcelle située en zone urbaine peut être ENAF si, dans les faits, elle en a les caractéristiques et l’usage (pt. 11).
- Point de départ de la consommation :Seule la transformation effective du sol (à compter du démarrage effectif des travaux), et non la simple délivrance d’une autorisation d’urbanisme, constitue le fait générateur de la consommation d’ENAF. Le fascicule reprend donc fidèlement les termes et l’esprit du législateur (pt. 12).
- Égalité entre collectivités :Les mentions du fascicule n’affectent pas, à elles seules, la répartition des objectifs entre collectivités locales, rendant cet argument inopérant (pt. 14).
- Rejet de la demande :La commune de Cambrai n'est pas fondée à demander l’annulation ; l’interprétation administrative contestée est conforme à la loi (pt. 15).
Synthèse pour les porteurs de projet :
Cette décision clarifie utilement la méthode de calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans le cadre de la réforme ZAN :
- Seule la transformation effective de l’usage du sol, constatée matériellement, marque le point de départ de la « consommation ».
- La qualification de ces espaces dépend des faits et non du classement réglementaire.
- Les guides et fascicules administratifs, même non réglementaires, peuvent faire l’objet d’un recours si leur interprétation a des effets notables.
Pour les porteurs de projets et collectivités, il importe :
- De raisonner sur la réalité de l’occupation et l’usage du sol (et non le seul zonage).
- De veiller à la traçabilité de la transformation effective des terrains pour la comptabilisation au titre des objectifs ZAN.
- D’intégrer cette logique dans leur stratégie d’aménagement, de planification urbaine et dans la gestion des autorisations d’urbanisme.
Autres articles
Travaillons ensemble
Que vous lanciez un projet immobilier, énergétique ou territorial, le cabinet vous accompagne avec rigueur, agilité et précision. Discutons ensemble de vos enjeux juridiques.